|
|
|

Après les
vulgaires loulous de banlieue, l'incivilité
continuerait-elle à gagner du terrain ?
|
|
L'enquête sur la torture qui accable les
Etats-Unis.
Libération,
mardi 4 mai 2004
- Pascal Riche
Contrairement à ce que
pouvait espérer le Pentagone
la semaine dernière,
l'affaire des sévices
infligés à des Irakiens
détenus dans la prison
d'Abou Gharib, à la fin de
l'année dernière, ne va pas
être oubliée rapidement.
Lorsque ces photos de
tortures ont été diffusées
par la chaîne de télévision
CBS, puis sont apparues dans
la presse, les autorités ont
annoncé des poursuites
criminelles contre les
auteurs d'actes «indignes
d'Américains», identifiés
comme une demi-douzaine de
réservistes de la police
militaire issus de milieux
ruraux. Ce week-end,
pourtant, un article publié
par le magazine New Yorker,
signé par le vétéran du
journalisme d'enquête
Seymour Hersh, a donné à
l'affaire une tournure
beaucoup plus grave. Hersh a
obtenu un rapport d'enquête
interne à l'armée de 53
pages. Il en ressort que les
sévices à Abou Gharib
étaient non seulement
courants, mais même
encouragés par des officiers
du renseignement militaire.
Ce rapport, rédigé par le
général Antonio Taguba,
évoque «des actes criminels,
sadiques, honteux,
gratuits», commis par au
moins six soldats de la
police militaire, avec la
bénédiction de supérieurs.
Ils semblaient relever de la
routine, et ceux qui les
commettaient ne paraissaient
craindre aucune sanction.
La générale Janis Karpinski,
qui était responsable des
prisons militaires
américaines en Irak à
l'époque, a réagi
publiquement à ces
révélations. Elle ne tient
pas à être seule à porter le
chapeau et a expliqué à
plusieurs médias que la
partie de la prison où ces
sévices avaient lieu était
placée sous l'autorité du
renseignement militaire.
Elle jure qu'elle n'était au
courant de rien. «Il y a eu
des actes ignobles. Si
j'avais été au courant,
j'aurais certainement réagi
très rapidement», se
défend-elle. Elle pense que
les sévices étaient
encouragés par des
officiers, aujourd'hui
protégés, qui voulaient
«casser» les détenus avant
de les interroger. Son
aveuglement, avec le recul,
paraît extrêmement naïf : en
décembre, elle avait déclaré
au quotidien St Petersburg
Times de Floride que la vie
des prisonniers à Abou
Gharib était «meilleure que
chez eux. Au point que nous
craignons qu'ils ne
veuillent plus en partir».
En janvier, la générale
Karpinski a été suspendue et
des enquêtes diligentées.
Humiliations. Le
rapport cité par Seymour
Hersh a été rédigé en
février. Les sévices qu'il
décrit (lire ci-contre) se
sont déroulés entre octobre
et décembre 2003. Ils ont
toujours une composante
sexuelle humiliante : il
s'agissait de dénuder les
détenus ; de leur faire
simuler (ou subir) des actes
homosexuels ; de les
sodomiser avec une torche ou
un manche à balai. L'avocat
du sergent Ivan Frederick,
l'un des six réservistes
poursuivis, entend démontrer
que son client a agi sur
ordre. Selon lui, les
techniques utilisées
trahissent la présence,
derrière ces tortures, de
spécialistes du
renseignement. «Pensez-vous
vraiment que quelques gosses
venant de la Virginie rurale
aient pu décider d'eux-mêmes
que le meilleur moyen pour
embarrasser des Arabes et
les faire parler était de
les forcer à marcher nus ?»
a-t-il expliqué au New
Yorker. Dans des lettres à
sa famille, Frederick décrit
d'ailleurs le rôle joué par
les équipes de renseignement
: «J'ai posé des questions
sur ce que j'ai vu, comme
laisser les prisonniers dans
leurs cellules sans
vêtements ou dans des
sous-vêtements de femmes
[...] et la seule réponse
que j'aie eue, c'était : "Le
renseignement militaire veut
que ce soit ainsi"», a-t-il
écrit en janvier, quand les
choses ont commencé à
tourner mal pour lui. Il
raconte également qu'en
novembre un prisonnier a été
si durement interrogé par
les services de
renseignements «non
militaires» (probablement la
CIA et ses officines
paramilitaires) «que l'homme
en est mort».
Le général Taguba, dans son
rapport, semble pour sa part
convaincu de la
responsabilité directe
d'officiers du renseignement
et met en cause l'ensemble
de l'encadrement de la
prison : personnel
militaire, CIA, mais aussi
gardes privés. Il dénonce
des problèmes de
commandement, accuse la
générale Karpinski de ne pas
avoir assis son autorité
face au renseignement
militaire. Et pointe enfin
de graves lacunes dans la
formation du personnel
chargé de la prison.
La publication du contenu de
ce rapport a pris de court
le Pentagone. Tel un
pompier, le général Richard
Myers, chef d'état-major
interarmes, a dû être
dépêché dimanche sur les
plateaux de télévision pour
minimiser l'affaire et
défendre l'honneur de
l'armée américaine. Mais ses
justifications manquaient de
cohérence. Il a évoqué les
actes d'une «poignée» de
soldats, mais n'a pas pour
autant exclu la possibilité
de pratiques plus
systématiques. «Préparer les
conditions
d'interrogatoires, ça se
fait évidemment. Mais il y a
une chose que nous ne
faisons pas : nous ne
torturons pas», a-t-il juré.
Tout en assurant quand même
qu'il fallait vérifier
«qu'il n'existe pas de
problème systémique» au sein
de l'armée en Irak. Signe de
l'embarras que l'affaire
soulève à Washington, le
général Myers a reconnu
qu'il avait demandé à
l'émission 60 minutes II de
CBS de retarder la diffusion
des photos des sévices, pour
ne pas aggraver la tension
en Irak.
Sanctions. Hier,
l'armée a annoncé que des
mesures disciplinaires
avaient été prises contre
sept officiers. Six d'entre
eux ont reçu un blâme écrit,
le septième un
avertissement. Tous ont fait
appel. L'attribution des
blâmes, si elle est
confirmée, bloquera la
carrière de ces officiers.
Mais il n'est pas question
pour le moment de les
traduire en cour martiale.
La générale Karpinski figure
parmi les sept militaires
sanctionnés |
|
(source) |
|
|

Le soleil se
couche sur les champs de pétrole |
|
Les réserves de pétrole sont dangereusement
surévaluées, dénonce un groupe d'experts.
Tranfert.net,
28 novembre 2003, 19h19.
- Matthieu Auzanneau
Etats et grands groupes
mentent sciemment sur
l'imminence du "peak oil",
prélude au déclin pétrolier
L'affaire est entendue, le
monde devra bientôt se
passer de pétrole. Mais
quand exactement ?
Mystère... Voilà trois ans
que BP Amoco a adopté son
nouveau slogan :
"Au-delà du
pétrole". Pourtant,
aucune donnée officielle sur
la production pétrolière ne
mentionne de déclin des
extractions avant (au pire)
2030. Depuis quelques mois,
un contre-discours officieux
s'impose peu à peu de
colloques spécialisés en
sites web. Il est
nettement moins optimiste.
Le "peak oil"
- c'est-à-dire l'instant à
partir duquel la production
pétrolière mondiale va
commencer à s'effondrer
irrémédiablement, faute de
réserves suffisantes - ne
serait pas pour 2030, mais
juste là, "à
portée de main". Le pic
de production pétrolière
pourrait même être déjà en
cours sans que personne
n'ait encore pu s'en
apercevoir !
L'association qui, depuis
2001, tient ce discours pour
le moins iconoclaste sur
l'avenir du pétrole mondial
s'appelle l'Aspo :
Association
for the study of peak oil.
Elle rassemble plusieurs
départements universitaires
européens de géologie autour
d'un noyau dur d'une dizaine
de retraités bénévoles, tous
anciens hauts responsables
de la prospection de groupes
pétroliers tels que Fina,
Total ou Shell.
Vers un choc pétrolier
permanent
Officieusement admise depuis
toujours par les
connaisseurs du monde
pétrolier, la falsification
des données officielles sur
les réserves de pétrole
encore disponibles serait
systématique, clament les
membres de l'Aspo.
L'accusation concerne à la
fois les Etats qui
produisent le pétrole, ceux
qui le consomment ainsi que
les groupes privés qui le
vendent.
L'Aspo met le monde en
garde : le
peak oil entraînera un
choc pétrolier permanent aux
conséquences vertigineuses.
Seront touchés non seulement
les transports qui, d'après
l'OCDE, dépendent toujours à
plus de 96% des
hydrocarbures, mais aussi
les grands équilibres
géopolitiques, l'industrie,
la production agricole et,
in fine,
la démographie planétaire.
"Pas de plan B"
"Aujourd'hui, je crois que
le peak oil
ne pourra
être correctement prédit
qu'une fois qu'il aura déjà
eu lieu. Ce qui est certain,
c'est qu'il va arriver. Et
mon analyse personnelle me
porte à croire que le pic
est déjà là, à portée de
main, et pas à plusieurs
années devant nous. Si j'ai
tort, eh bien j'ai tort.
Mais si j'ai raison, les
conséquences seront
imprévisibles et
dévastatrices. Si j'ai
raison, malheureusement le
monde ne dispose d'aucun
plan B. A la fin des années
soixante, les humanistes du
"club de Rome"
avaient
raison de pointer du doigt
les "limites
de la croissance."
L'homme qui s'est exprimé
ainsi le 27 mai dernier,
lors d'une conférence de l'Aspo
organisée dans les locaux de
l'Institut français du
pétrole, est tout sauf un
écologiste confit de
paranoïa. Matthew Simmons,
un banquier d'affaires, a
été l'un des principaux
conseillers du
vice-président américain
Dick Cheney au sein de la
task force
chargée en 2001 d'élaborer
la politique énergétique de
l'administration Bush. Les
experts de ce groupe étaient
pour la plupart issus des
entreprises de l'énergie
américaines, et leur
partialité en faveur du
lobby
texan du pétrole est
aujourd'hui
vivement critiquée aux
Etats-Unis.
Le débat sur l'imminence du
peak oil
n'est pas cantonné à
quelques obscurs
laboratoires de géologie
indépendants. Jean Laherrère
est le seul français parmi
les membres fondateurs de l'Aspo.
Aujourd'hui retraité et
bénévole, ce géologue a
travaillé pendant
trente-sept ans pour Total,
et a longtemps été le patron
des techniques d'exploration
du groupe. Il témoigne :
"Cela fait
50 ans que les experts
tentent d'anticiper le
peak oil .
Aujourd'hui, tout le
landernau pétrolier connaît
les thèses de l'Aspo. Mais
le grand public, lui, ne les
connaît pas encore (...) Les
Browne (patron de BP,
ndlr),
Cheney (ancien patron du
géant américain Halliburton)
et autres
Khodorkovsky (ancien
patron du groupe russe Yukos,
arrêté par le Kremlin en
octobre)
sont parfaitement au courant
du problème. Voir naître un
débat autour de
l'authenticité des chiffres
officiels sur les réserves
de pétrole est sans doute la
dernière chose au monde que
souhaitent ces gens-là."
Pour l'instant, ils n'ont
pas à s'en faire. Selon
Laherrère, les experts en
prospective énergétique du
ministère français de
l'Industrie ne disposent pas
de données fiables sur les
réserves pétrolières. Leur
niveau d'alerte vis-à-vis de
l'imminence du
peak oil
est "nul",
déclare-t-il. Laherrère va
plus loin :
"Aujourd'hui, il est
impossible pour un
pétro-géologue de parler
ouvertement du peak oil s'il
n'est pas à la retraite."
L'ancien responsable de la
prospection de Total se
refuse toutefois à parler d'"omerta"
ou de
"désinformation".
Pourtant...
Des
réserves "prouvées" très
subjectives
Les experts de l'Aspo
pointent du doigt des biais
et des tricheries
systématiques dans la
mesure, le report et
l'agrégation des réserves
des champs pétrolifères de
la planète.
Le docteur Colin Campbell
est le fondateur de l'Aspo.
Après avoir soutenu sa thèse
à Oxford en 1957, cet
Anglais a passé près de 40
ans dans l'exploration et
l'évaluation de champs
pétroliers. Il dit :
"La mesure
de ce que contient un champ
pétrolier est toujours en
partie subjective. C'est un
simple pari de géologue."
L'expert anglais ajoute :
"Pour parler
de ce qui reste dans un
champ en exploitation, on
utilise l'expression
"réserves prouvées"
qui ne
correspond en fait qu'à un
calcul de probabilité dont
les critères varient selon
que l'on travaille pour les
Etats-Unis, la France ou la
Russie."
Les chiffres officiels sur
les réserves "restant à
découvrir" sont exprimés à
travers trois valeurs
différentes, appelées F95,
F50 et F5. La première
indique la quantité de
pétrole disponible avec une
probabilité de 95 %, la
seconde avec une probabilité
de 50 %, la troisième avec 5
%. Pour l'Algérie, les
données de référence
publiées par l'organisme
officiel américain
USGS (United
States geological survey)
indiquent que ce pays a :
- 95 % de chances de
découvrir encore 1,7
milliard de barils de
pétrole conventionnel ;
- 50 % de chances de
découvrir 6,9 milliards de
barrils ;
- 5 % de chances d'en
découvrir 16,3 milliards.
Or dans les rapports sur
lesquels s'appuient les
gouvernements, les banques
ou les actionnaires, on ne
retient en général qu'une
valeur médiane, appelée ("Mean"),
entre les trois niveaux de
probabilité. Pour l'Algérie,
cela donne 7,7 milliards de
barils. Peu importe qu'un
rapport de presque 1 à 10
sépare F95 et F5. Et que le
chiffre finalement retenu
ait moins d'une chance sur
deux de chances d'être
atteint !
46
% des réserves du
Moyen-Orient seraient
"douteuses"
Outre les inexactitudes, les
calculs sur l'avenir du
pétrole sont l'objet d'une
vraie gruge. En 1985, les
pays producteurs réunis au
sein de l'Opep ont pris la
décision, jugée fort saine à
l'époque, d'indexer leurs
quotas de production de
pétrole sur le montant des
réserves déclarées par
chaque pays membre. Mais des
faits étonnent : d'après les
données de référence
reprises par le groupe
anglais BP dans son rapport
2003 sur l'énergie mondiale,
l'Arabie Saoudite est
passée, entre 1985 et 1990,
de 169 milliards de barils
de réserves
"prouvées" de pétrole
conventionnel à... 258
milliards, soit 50% de
plus ! Tous les principaux
pays producteurs de l'Opep
sont dans la même
situation : Abu Dhabi (30
milliards de barils déclarés
en 1985 contre 92 milliards
en 1988), Iran (48 milliards
en 1985, 92 milliards en
1988), Irak (44 milliards en
1985, 100 milliards en
1988), etc. Le tout sans
qu'aucune découverte
significative de nouveaux
champ pétrolifère n'ait eu
lieu dans ces pays au cours
de la période...
Au total, selon Colin
Campbell, de l'Aspo, 46 %
des ressources actuelles
déclarées par les principaux
pays de l'Opep sont
"douteuses,
sinon fausses".
Laherrère décrit l'exemple
du champ pétrolifère de
Cusiana, en Colombie,
découvert en 1988. Le
géologue raconte :
"Triton, la
compagnie américaine qui
s'est chargée de
l'évaluation des ressources
de Cusiana a commencé par
parler de 3 milliards de
barils, une valeur
remarquable, qui n'a pas
laissé Wall Street
indifférente. Triton devait
vraiment avoir besoin de
l'argent de ses
actionnaires, parce que
lorsque BP a démarré
l'exploitation de Cusiana,
ils sont prudemment
redescendus à 1,5 milliards
de barils. Et je pense qu'au
final, il y a à peine 800
millions de barils
là-bas..."
Sous la pression financière
Si les pays producteurs
exagèrent leurs ressources,
c'est aussi parce qu'elles
permettent d'obtenir plus
facilement des prêts
bancaires. Jean Laherrère
commente :
"Les chiffres officiels des
réserves pétrolières, sont
loin d'être des données
purement scientifiques.
C'est le reflet d'un
patrimoine financier que les
Etats valorisent ou
déprécient selon leur
intérêt du moment."
Pour l'Aspo, l'ensemble de
ces sources d'exagérations
contribuent à faire croire
que le peak
oil, et la flambée qu'il
entraînera sur les prix,
n'arrivera pas avant
après-demain. La réalité
pourrait être tout autre :
"Compte tenu
de l'opacité des données, il
se peut très bien que le pic
soit déjà derrière nous",
prévient Colin Campbell.
L'expert fondateur de l'Aspo
a publié un
article dans lequel il
estime à 1750 milliards de
barils les réserves totales
de pétrole conventionnel
(déjà découvertes +
probables). Côté USGS, le
chiffre officiel est de 3000
milliards de barils, soit
1,7 fois plus.
L'USGS n'est pas un
organisme indépendant : il
dépend directement du
département américain de
l'Intérieur. Son rôle est
très politique. En 2000, la
publication des chiffres de
l'USGS sur les réserves de
pétrole a précédé d'une
semaine seulement une
importante réunion de l'Opep
sur les quotas futurs de
production
En 2002, la Douma a voté une
loi d'après laquelle révéler
les réserves de gaz et de
pétrole russe est un crime
passible de 7 ans de prison.
Laherrère remarque :
"Ces
tripatouillages ne seraient
pas graves si les pays
industriels essentiellement
consommateurs de pétrole,
comme la France, n'avaient
pas totalement renoncé à
mettre en question les
données qui leur sont
fournies par les pays
producteurs." Il
affirme :
"Aujourd'hui, l'Institut
français du pétrole et la
Direction générale des
énergies et matières
premières du ministère de
l'Industrie se fient
aveuglément à des données
produites et trafiquées par
d'autres. Il n'existe aucun
travail de vérification."
Et de conclure :
"En France,
la sensibilité de
l'administration vis-à-vis
de la question du peak oil
est tout simplement nulle !"
Lire la suite :
"Quand le déclin de la
production mondiale de
pétrole va-t-il débuter ?"
Le site de l'Aspo:
http://www.peakoil.net
OilCrisis.com:
http://www.oilcrisis.com/
Institut français du
pétrole:
http://www.ifp.fr
"L'impasse énergétique":
http://www.transfert.net/d51
|
|
(source) |
|
|

"Fresh Air, Fresh
Water, Our Birth Right"

L'usine
|
|
En Inde, le Coca donne soif aux paysans.
Libération,
jeudi
22 avril 2004.
Plachimada (Kerala, Inde) envoyé spécial
Notre commentaire: Pour résoudre
le problème, il faudrait délocaliser cette
industrie sur Mars, une solution parfaite pour
tout le monde! Sur Mars, il n'y a pas de taxes
et c'est une implantation stratégique pour le
marché Martien.
«L'eau pure, l'air
pur : notre droit de naissance», dit le petit
écriteau à l'entrée de l'usine Coca-Cola. Sous
une hutte en paille, une quinzaine d'hommes et
de femmes, assommés par la chaleur, montent la
garde. «Nous en sommes à notre 705e jour de
protestation, explique l'un d'entre eux. Nous
nous relayons pour être là en permanence. Nous
ne quitterons pas cette cabane tant que l'usine
n'aura pas définitivement fermé.» Bienvenue à
Plachimada, petit hameau de l'Etat du Kerala,
dans le sud de l'Inde, où une poignée de paysans
luttent avec acharnement contre la plus connue
des multinationales, accusée de piller les eaux
souterraines en fabriquant ses célèbres boissons
gazeuses. Un «David contre Goliath» version
écolo-altermondialiste, dans lequel le plus
petit, pour l'instant, l'emporte. Mettant
temporairement fin au bras de fer, la haute cour
du Kerala a en effet validé début mars la
décision du gouvernement local de fermer le site
jusqu'à l'arrivée de la mousson, afin de laisser
le temps aux nappes phréatiques de se remplir.
Estimant que les ressources aquifères étaient
une «propriété publique» à laquelle «tous les
êtres humains» pouvaient prétendre, ce tribunal
avait déjà ordonné à Coca, en décembre, de
limiter sa consommation d'eau au minimum, soit
l'équivalent de ce que pomperait une
exploitation agricole de 15 hectares, la taille
du terrain qui abrite l'usine.
«Or bleu». Car,
dans cette région autrefois connue comme le
«grenier à riz» du Kerala, l'«or bleu» manque
cruellement. A tel point que les autorités sont
obligées d'envoyer des camions-citernes pour
approvisionner les villageois en eau potable.
«Le camion ne vient au mieux que tous les deux
jours, et quand il est là, la bagarre est telle
que nous n'avons jamais assez d'eau pour toute
la famille», se lamente Kalipan en désignant une
flopée d'enfants qui jouent dans la poussière.
«Avant, je faisais tourner ma pompe toute la
nuit, ajoute Krishnaswami, un agriculteur dont
les terres jouxtent l'usine. Aujourd'hui, il n'y
a plus d'eau au bout de deux heures. J'ai été
obligé d'abandonner les rizières pour ne faire
que de la noix de coco. Mes revenus ont
tellement chuté que j'ai dû me débarrasser de
tous mes employés.» «Avant, il y avait deux
récoltes de riz par an, ce qui nous assurait six
ou sept mois de travail, explique un saisonnier.
Maintenant, nous avons de la chance si nous
arrivons à toucher trois mois de salaire. Cette
usine nous a volé nos emplois.»
Devenue un
symbole de la lutte contre l'exploitation
commerciale de l'eau, la bataille de Plachimada
dure depuis deux ans. Montré du doigt par les
écologistes et les altermondialistes de tous
bords, Coca-Cola affirme n'être pour rien dans
l'épuisement des nappes phréatiques, rejetant la
faute sur la sécheresse. De fait, les
précipitations dans la région ont été bien en
dessous de la moyenne ces deux dernières années.
«Nous avons connu d'autres sécheresses par le
passé, mais la situation n'a jamais été aussi
dramatique, nous avions au moins de quoi boire,
rétorque Aruchami Krishnan, le président du
conseil des villages de Purumatty, dont
Plachimada fait partie. Et même si la mousson
est seule responsable, la présence de l'usine ne
peut de toute façon qu'aggraver les choses.»
En vertu de
l'accord signé avec les autorités locales lors
de l'ouverture de l'usine, en 2000, Coca-Cola a
le droit de pomper 560 000 litres par jour. La
compagnie affirme être en dessous de ce seuil,
déclaration invérifiable puisque les huit puits
du site n'étaient pas, jusqu'à peu, équipés de
compteurs. Insistant sur le fait que l'usine est
dotée du label écologique ISO 14 001, Coca met
aussi en avant la mise en place d'un important
dispositif de récupération d'eau de pluie qui
aurait déjà permis de renflouer les nappes de 12
millions de litres. «Le système a été conçu
après le début de la polémique, sourit toutefois
un journaliste qui suit le dossier depuis le
début. Ça ressemble surtout à un exercice de
relations publiques.» Le groupe, lui, affirme
que le système faisait partie des plans de
l'usine dès son origine... Mystère, mais le
label ISO 14 001 ne date que d'avril 2003.
«Antiaméricanisme». Catastrophique pour l'image
du géant mondial des boissons gazeuses, la
polémique de Plachimada a été aggravée, l'an
dernier, par la découverte de métaux lourds dans
les déchets de l'usine, que la direction
distribuait gratuitement comme engrais aux
paysans des alentours... Résultat : des taux
élevés de plomb et de cadmium dans les puits,
dans les champs, et donc dans la chaîne
alimentaire, avec des conséquences inconnues sur
la santé. A sa décharge, Coca a immédiatement
rapatrié les «engrais» non utilisés, mais
maintient pour autant que ceux-ci sont
inoffensifs. Bizarrement, les analyses
diffèrent, mais les soupçons sont néanmoins
lourds, d'autant qu'une autre usine
sous-traitante a confirmé la présence de ces
substances toxiques. Les habitants de Plachimada,
en tout cas, affirment tous souffrir de
démangeaisons lorsqu'ils se lavent avec l'eau
des puits.
Réfutant toutes
les accusations, Coke se dit victime de
«règlements de comptes politiques et
d'antiaméricanisme». «Il est difficile de
comprendre pourquoi nous sommes les seuls à être
pris pour cible alors qu'il y a dans la région
vingt-sept autres industries qui utilisent pour
certaines plus d'eau que nous», argumente Sunil
Gupta, vice-président de Coca-Cola India. «C'est
vrai que la focalisation sur Coca est un peu
injuste, avoue un journaliste local, mais ils
payent le prix de leur nom et leur implantation
dans une zone agricole alors que les autres
usines sont regroupées dans des sites
industriels.»
Grand seigneur,
Coke affirme ne pas vouloir fermer l'usine «car
elle génère des revenus indispensables pour des
milliers de locaux». Cinq cents familles, en
l'occurrence, qui sont évidemment furieuses
d'avoir soudainement perdu leur gagne-pain.
Devant l'usine, la cabane du Comité de lutte
anti-Coca-Cola fait ainsi face depuis un mois et
demi à celle du Comité de protection des emplois
Coca-Cola. «Les anti sont justes frustrés de
n'avoir pas été embauchés», affirment ces
derniers. «Le droit à la vie est supérieur à la
sécurité de l'emploi», rétorquent leurs
adversaires.
(source) |
|
|

L'ancien mur trop
petit

Le nouveau
(en construction) |
|
Sharon modernise Israël, mais Dieu lève le camp.
Pariroma,
mercredi
14 avril 2004

Selon notre
source, d'après les services de renseignement
américains, Dieu, père et fils, sont tous deux
partis d'Israël pour une destination inconnue,
peut-être en Inde. Toujours selon les même
sources, les derniers combats auraient été la
goutte d'eau de trop qui aurait causé leur
départ. Ils ont abandonnés l'endroit à son
destin, lequel pullule de mitraillettes,
militaires, chars de combat et autres
distractions. On a des doutes sur ce qu'il reste
de la sainteté de cette terre...
|
|
|

Manifestation à
Bagdag |
|
Tous contre l'occupation
Courrier International,
dimanche
11 avril 2004
Combats de rue et
prises d’otages : un an après la chute du régime
de Saddam Hussein, l’Irak s’enfonce dans le
chaos et les forces de la coalition semblent
débordées par la révolte qui se propage à
travers le pays.
“Trois Japonais
sont détenus en otages en Irak”, titre en une
The Japan Times, avant de préciser qu’il s’agit
de trois civils enlevés par un groupe de
terroristes qui menacent de les “brûler vifs
dans les trois prochains jours [à dater du jeudi
8 avril] si le gouvernement japonais ne retire
pas ses troupes d’Irak”. Le Premier ministre,
Junichiro Koizumi, a demandé “la libération
immédiate des otages” et annoncé qu’il n’était
“pas question d’envisager une évacuation” de la
base de Samawwa, dans le sud de l’Irak, où sont
stationnés quelque 550 militaires japonais
“chargés d’une mission pacifique concernant
l’aide à la reconstruction”, souligne le
quotidien.
"Depuis la
Seconde Guerre mondiale, c’est le déploiement
militaire le plus risqué effectué par le Japon.
Pour l’opposition, c’est une violation de la
Constitution pacifiste du pays”, rappelle The
Japan Times, qui estime que “toute perte humaine
japonaise liée à l’envoi de troupes en Irak
portera un coup dur au Premier ministre”. L’Asahi
Shimbun s’alarme d’ailleurs et prévient dans un
éditorial : “Bush ne devrait pas laisser l’Irak
devenir son Vietnam”. Le quotidien relève que
les Américains ont perdu 12 soldats dans les
combats de rue qui ont eu lieu ces derniers
jours à Ramadi, à l’ouest de Bagdad. “Depuis la
déclaration faite en mai 2003 par le président
américain George W. Bush annonçant la fin de la
guerre en Irak, cela représente le plus grand
nombre de morts tombés sur un seul champ de
bataille.”
L’Asahi Shimbun
note que la fermeté affichée par
l’administration Bush, qui maintient la date du
30 juin 2004 pour le transfert du pouvoir aux
Irakiens, est “probablement dictée par le
calendrier électoral américain et par l’élection
présidentielle qui doit se dérouler à l’automne
[en novembre]”. Mais le quotidien relève que le
recours systématique à la force pour régler les
crises est une erreur que “la Maison-Blanche
semble prête à répéter pour régler la crise en
cours”.
Quant aux sept
Sud-Coréens enlevés près de Bagdad, “ils ont été
ensuite libérés et ils sont sains et saufs”,
relate le Chosun Ilbo. Le quotidien s’inquiète
des “changements rapides qui ont lieu en Irak”
et appelle à “une grande vigilance. L’armée
levée par le jeune religieux antiaméricain
Moqtada al-Sadr semble se former avec la
coopération des chiites modérés et des
sunnites.” Le Chosun Ilbo ne cache pas son
inquiétude et fait le même constat que le
quotidien japonais Asahi Shimbun. “La situation
s’est énormément dégradée, à tel point que
plusieurs personnes craignent que ce conflit ne
devienne un second Vietnam.” En attendant, le
gouvernement sud-coréen a déclaré qu’il
maintiendra ses troupes en Irak et il a confirmé
l’envoi de nouveaux contingents, conformément à
ses engagements au sein de la coalition.
Par ailleurs,
le sort de deux Arabes israéliens originaires de
Jérusalem-Est enlevés par un groupe se nommant
Ansar a-Din, reste plus confus, relate Ha’Aretz,
avant de préciser : “Selon une source du
ministère de la Défense, Israël ne négociera pas
pour la libération de ces deux otages. Les deux
personnes concernées ont voyagé en Irak de leur
propre initiative, contrairement à la loi.”
Ansar a-Din a désigné les deux hommes comme
étant des “agents de l’ennemi sioniste”, mais
n’a fait aucune demande à Israël ni fixé
d’ultimatum menaçant les vies des prisonniers,
poursuit le quotidien israélien. Ha’Aretz
signale que “l’un des deux hommes serait employé
par l’Agence américaine du développement
international (USAID). Des contacts ont été pris
par Israël avec le département d’Etat américain
pour avoir plus d’informations.”
De violents
affrontements se poursuivent dans le “triangle
sunnite” à l’ouest et au nord de Bagdad,
rapporte Al Quds al-Arabi. L’armée américaine a
également reconnu, le jeudi 8 avril, que les
forces de la coalition avaient perdu le contrôle
des villes de Nadjaf et de Kout, dans le sud et
l’est du pays, en proie à une insurrection
chiite, poursuit ce quotidien panarabe édité à
Londres. Des combats ont également éclaté dans
les faubourgs de Bagdad et à Kerbala (ville
sainte chiite au sud de l’Irak), où des
centaines de milliers de chiites convergent pour
l’Arbaïn (commémoration du quarantième jour
après Achoura), une importante fête religieuse
pour la communauté chiite.
Al Quds
al-Arabi souligne que “les manifestations à
Bagdad ainsi qu’à Mossoul et à Baaqouba, dans le
nord du pays, réunissent des milliers de chiites
et de sunnites. Lors de ces rassemblements, les
manifestants scandent à l’unisson de violents
slogans hostiles aux Etats-Unis. La résistance
unit les Irakiens.” Ce journal - qui avait, dès
le début, manifesté avec véhémence son
opposition à l’intervention américaine en Irak -
revient sur les critiques et les mises en garde
qu’il avait formulées il y a un an, constatant
que “l’insécurité est de mise partout dans le
monde. La lutte contre le terrorisme n’a obtenu
aucun résultat. L’occupation de l’Irak a encore
aggravé la situation. C’était cela les objectifs
de George W. Bush et de son allié Tony Blair ?”
Quant au
quotidien irakien Al Rafidayn, il rapporte le
déroulement des événements, prises d’otages et
combats, et souligne la démission “du ministre
de l’Intérieur irakien, qui a préféré se retirer
à la suite des critiques formulées par
l’administrateur civil américain Bremer”. A
noter que ce quotidien affiche en première page
de son site Internet un texte de “félicitations
à l’occasion du premier anniversaire de la chute
du régime de Saddam Hussein et de la libération
du peuple irakien du joug de la dictature. Nous
appelons les fils de la nation irakienne à
déjouer les plans des envieux qui se réjouissent
de nos malheurs. Soyons solidaires et unis pour
reconstruire le nouvel Irak.” Ce texte est
agrémenté de deux roses rouges et côtoie un
appel pour la libération des otages Japonais.
Hoda Saliby
(source) |
|
|
|
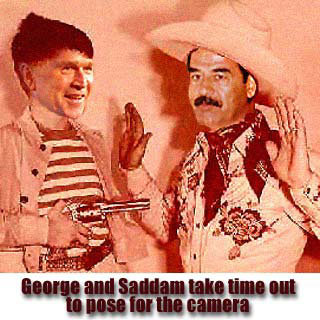 La
restitution des millions de Saddam Hussein
tourne au bras de fer entre le gouvernement
suisse et le gouvernement américain La
restitution des millions de Saddam Hussein
tourne au bras de fer entre le gouvernement
suisse et le gouvernement américain
LE TEMPS,
5 février 2004
- Sylvain BESSON
PRESSIONS.
Washington s'impatiente et demande une
restitution rapide des fonds irakiens placés en
Suisse. A Berne, les réunions de crise se
multiplient. Au cœur des discussions : la
confiscation de plus de 100 millions de francs
contrôlés par un proche de l'ancien régime.
C'est un
rendez-vous inhabituel auquel s'est rendu, l'été
dernier à Genève, Mohammed al-Tikriti, le neveu
de Saddam Hussein. Dans un immeuble impersonnel
situé au 14, rue du Rhône, le jeune homme, qui
réside alors en Suisse, rencontre un
« diplomate » américain -en réalité, un agent de
la CIA- et un fonctionnaire suisse du Service
d'analyse et de prévention, l'ancienne police
fédérale. Objectif de cette opération
helvético-américaine : forcer l'héritier du clan
des Tikriti à révéler où sont cachés les fonds
secrets du régime de Saddam Hussein.
L'entretien
s'est très mal passé. Mohammed, venu négocier
des garanties pour lui et sa famille en échange
d'informations, s'est senti menacé et est
reparti furieux. Peu de temps après, il a commis
une erreur fatale en se rendant en Jordanie, où
il a été immédiatement arrêté et remis aux
Américains, qui le détiennent aujourd'hui dans
une prison de Bagdad. Mais les Américains ont un
problème : Mohammed et son père Barzan
al-Tikriti, demi-frère de Saddam Hussein, ancien
ambassadeur d'Irak en Suisse et maître présumé
des finances occultes de l'ancien régime, ne
parlent pas.
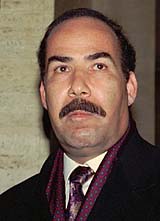
Barzan
Al-Tikriti
|
L'argent caché
reste introuvable, et Washington compte
désormais sur les enquêtes menées dans divers
pays - dont la Suisse - pour le découvrir. Les
capitaux retrouvés devront être versés au Fonds
de reconstruction de l'Irak, contrôlé par la
coalition dirigée par les Américains.
Depuis plusieurs
mois, ceux-ci multiplient les démarches auprès
de la Suisse pour obtenir la restitution des
fonds irakiens placés dans les banques
helvétiques. « Ils font pression, ils
téléphonent sans arrêt, ils viennent rendre
visite, accompagnés de différents fonctionnaires
venus de Washington », témoignent des initiés.
Au début, les Américains se montraient patients,
mais aujourd'hui, ils dissimulent mal leur
irritation. « Nous avons contacté toutes les
branches du gouvernement suisse sur cette
question, explique un officiel américain sous
couvert de l'anonymat : le Ministère public, les
Départements des finances, de la justice, de
l'économie, des affaires étrangères, les
services de renseignement... Il faut travailler
avec tous ces gens pour obtenir des résultats.
Parfois, c'est très frustrant. »
En mai dernier,
les autorités helvétiques assuraient que le
montant des fonds irakiens bloqués en Suisse en
vertu des résolutions de l'ONU serait publié
« d'ici une semaine ». Neuf mois plus tard, ce
chiffre n'est toujours pas disponible. Les noms
des proches de l'ancien régime ou des sociétés
d'Etat disposant de fonds en Suisse n'ont pas
été divulgués : « Les Suisses ne peuvent pas les
publier, à cause du secret bancaire », soupire
l'Américain précité. Mais les choses
s'accélèrent. Un projet d'ordonnance autorisant
la restitution des fonds des proches de l'ancien
régime et des entreprises d'Etat irakiennes -
dont certains sont bloqués depuis la première
Guerre du Golfe, en 1991 - circule depuis
quelques jours au sein de l'administration. Il
devrait entrer en vigueur début mars, « avant
que les Américains en aient vraiment assez »,
confie-t-on à Berne.
Washington a
quelques raisons de penser que les fonds
irakiens placés en Suisse sont importants. Dans
les années 90, la Banque nationale suisse les
évaluait à quelque 462 millions de francs. Selon
les services de renseignement suisses, Barzan
al-Tikriti, l'ambassadeur irakien à Genève,
contrôlait alors un réseau financier secret
depuis une société basée au Tessin, la MEDP.
« La MEDP était le cœur de son système »,
expliquait au Temps, en septembre dernier, Ayad
Allaoui, un membre du Conseil de gouvernement
irakien formé après la chute de Saddam Hussein.
En outre, le fils de Barzan, Mohammed, fait
figure de véritable héritier du clan des Tikriti.
Avant la chute du régime, il occupait depuis
Genève les fonctions de représentant de la
compagnie aérienne nationale, Iraqi airways.
La fortune placée en Suisse par la famille
al-Tikriti est, selon ses avocats genevois,
relativement modeste : moins de deux millions de
francs « provenant de la vente de terrains à
Bagdad ». L'ordonnance en préparation
permettrait la restitution de cette somme au
Fonds de reconstruction de l'Irak, mais la
famille s'y opposera énergiquement : « Une telle
restitution serait honteuse, choquante, un vrai
Guantanamo judiciaire », estime Alain Bionda, un
défenseur genevois de la famille Tikriti. Le
Tribunal fédéral tranchera en dernier recours.
Le cas le plus
délicat est celui de Khalaf al-Dulaimi, un
puissant homme d'affaires, chef de tribu et
présumé membre des services de renseignement
irakiens. Selon nos informations, plus de 100
millions de francs détenus par sa société
panaméenne, Montana Management, sont
actuellement bloqués dans une banque suisse.
« Nous savons qu'Al-Dulaimi est lié à l'ancien
régime, mais nous devons prouver qu'il est
vraiment le propriétaire de ces fonds »,
explique un fonctionnaire. L'Irakien et sa
société n'ont pas été placés sur la liste des
sanctions de l'ONU. Le Conseil fédéral doit très
prochainement décider du sort de cet argent.
S'il ordonnait sa restitution, il ferait un très
beau cadeau au Fonds de reconstruction de l'Irak
- et aux Américains.
Sylvain BESSON
Source:
www.Interet-General.info | |
|
|

Petite Chronique de
l'Europe
Note: L'histoire est
un plus complexe, il est à noter que là où l'eau fait défaut, il faudrait
commencer par ne pas créer de zone industrielle pour y inviter des
industries qui la consomme...
Article plus complet (en
anglais) :
Frontline
|


